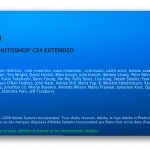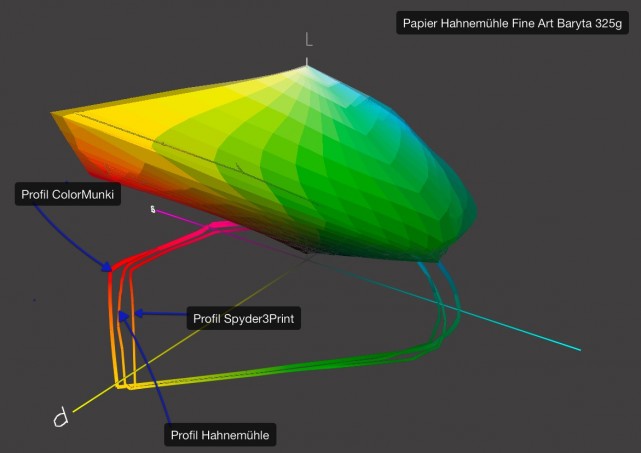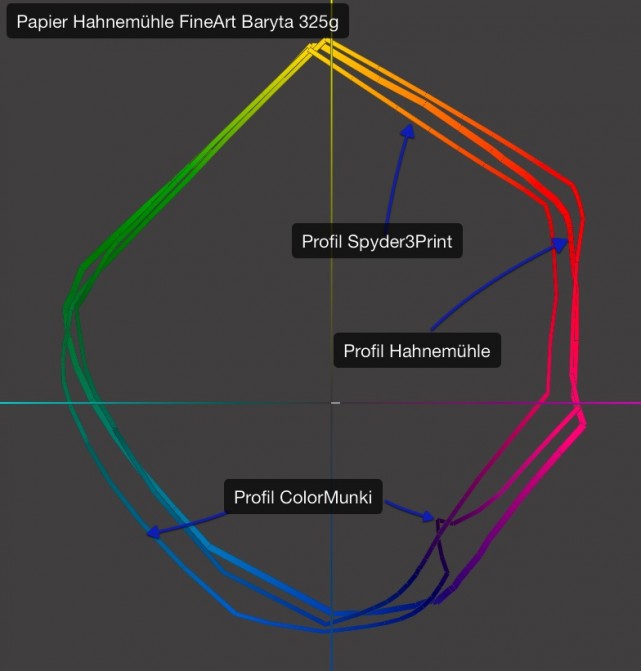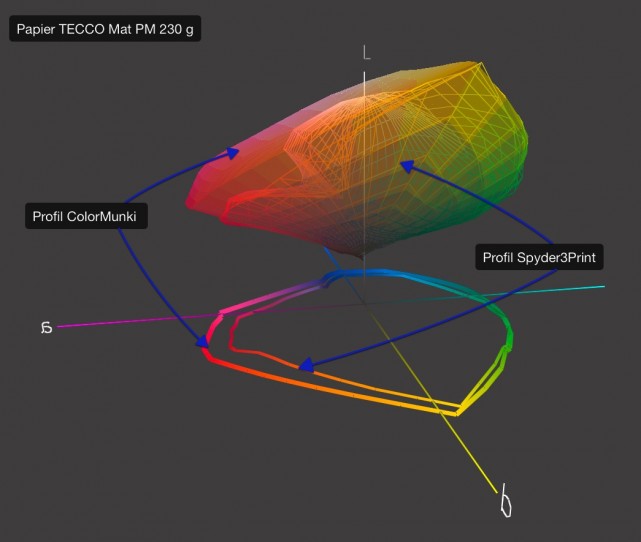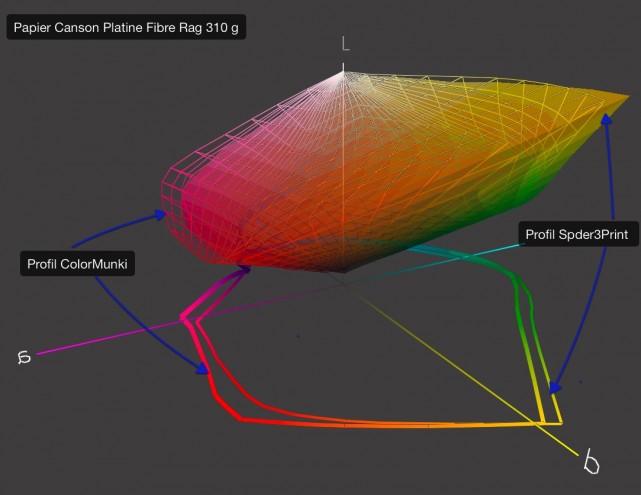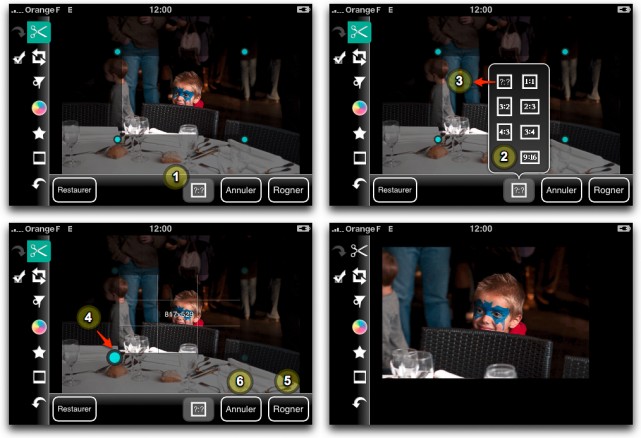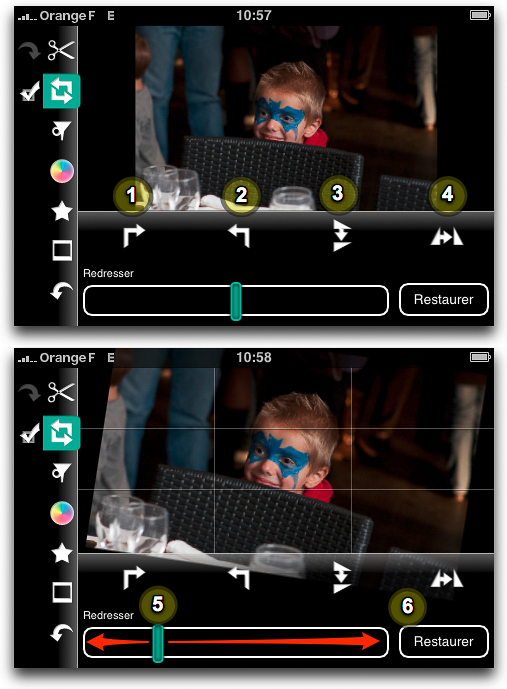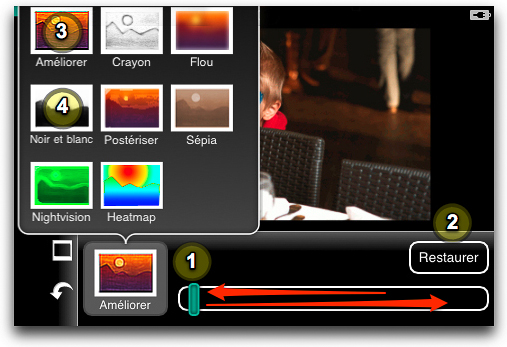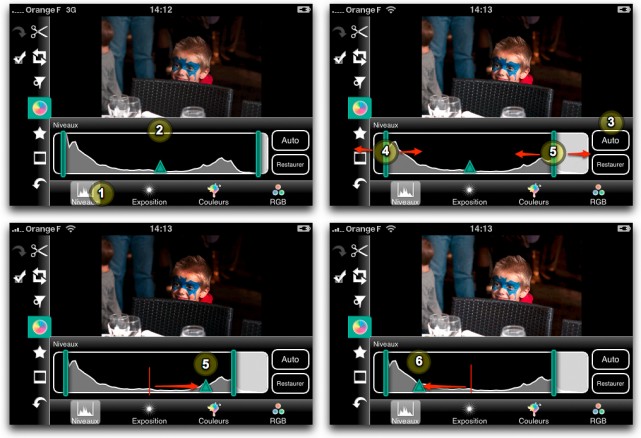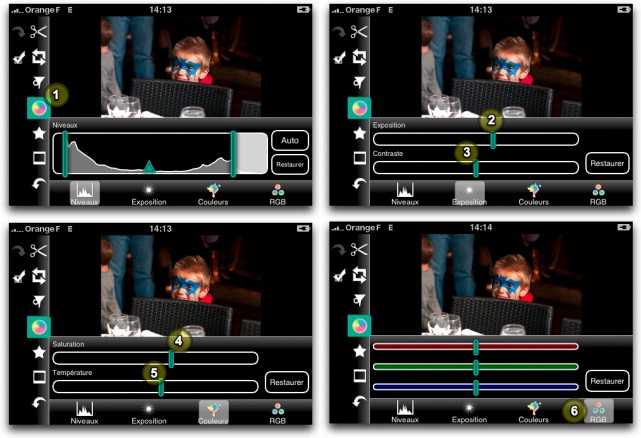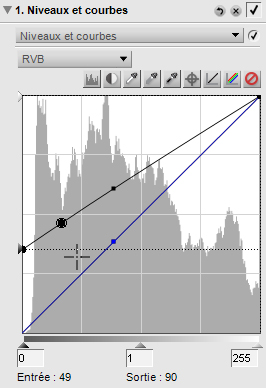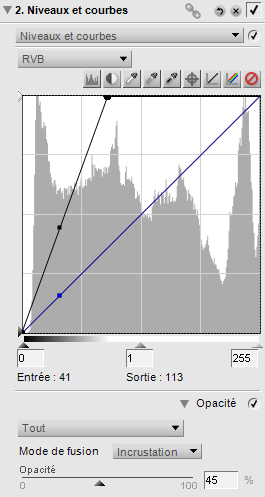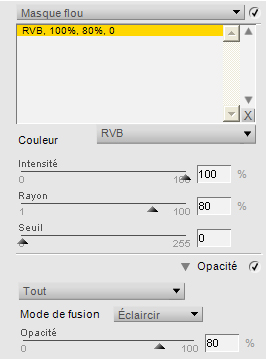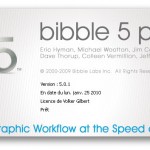« Maîtriser le Canon EOS 5D Mk II » en avant-première : choisir l’ouverture du diaphragme
Publié le 25 février 2010 dans Actualités Livres par Hélène Pouchot
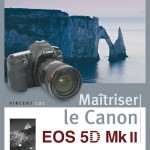
Enfin, la profondeur de champ est liée au format de prise de vue. Toutes choses demeurant égales par ailleurs ; elle est inversement proportionnelle à la taille du capteur. A cadrage et mise au point identiques, le format 24 × 36 mm du 5D Mark II offre donc une profondeur de champ moindre que celle que l’on obtient avec un EOS 7D par exemple (capteur APS-C 22,3 × 14,9 mm). L’incidence du format sur la profondeur de champ est heureusement linéaire. Ainsi, on considère que pour disposer d’une zone de netteté sensiblement équivalente à celle qu’offre un capteur APS-C dans les mêmes conditions, un capteur 24 × 36 implique de “fermer” d’une valeur voire une valeur et demie.
De fait, selon le contexte de prise de vue, le 5D Mark II peut s’avérer plus ou moins pratique. D’un point de vue esthétique, pouvoir disposer d’une faible profondeur de champ est incontestablement une aubaine. En vidéo, on peut obtenir un “effet cinéma” jusqu’alors inaccessible du fait de la petite taille des capteurs des caméras et des caméscopes. En photo, cela permet à celles et ceux qui l’ont connu (ou la pratiquent encore avec plaisir !) de retrouver, enfin, en numérique, des flous d’arrière-plan et des effets qui se rapprochent de ceux de la photo argentique 24 × 36 mm et qui sont pratiquement impossibles à rendre avec un capteur APS-C.
Inversement, en macro, en publicité ou en paysage, la profondeur de champ a priori supérieure d’un “petit” capteur conserve des avantages. En effet, réduire l’ouverture du diaphragme pour augmenter la profondeur de champ n’est pas sans poser quelques problèmes : en termes d’exposition, il n’est pas toujours possible de conserver un temps de pose assez bref pour échapper au flou du sujet ou du photographe et, sur le plan technique, on peut alors difficilement éviter la diffraction (voir plus loin)…
Évaluer la profondeur de champ
Avec un reflex, la visée s’effectue toujours à pleine ouverture. Le viseur est donc d’autant plus clair que l’optique est lumineuse mais de fait, l’image présente systématiquement une profondeur minimale. Ce qui est fondamental pour réaliser la mise au point (surtout en manuel) ne permet pas d’apprécier concrètement l‘étendue de la zone de netteté de la photo puisque, dans la grande majorité des cas, celle-ci sera réalisée avec une autre ouverture du diaphragme. Or, anticiper l’effet de la profondeur de champ avant la prise de vue est souvent utile (si ce n’est nécessaire) pour sélectionner la valeur adaptée à l’effet escompté. On peut alors opérer de différentes façons.
Par la pratique : test et échelle de profondeur de champ
La solution la plus simple est d’utiliser le test de profondeur de champ qui provoque une fermeture temporaire du diaphragme à la valeur de travail ; on vérifie ainsi visuellement la zone de netteté.

Sur le 5D Mark II, le test de profondeur de champ bénéficie d’une touche dédiée sur le flanc gauche de la baïonnette (voir mode d’emploi page 93). La visée se trouve alors d’autant plus obscurcie que l’ouverture est faible, mais si la lumière est abondante ou qu’on laisse à l‘œil le temps de s’adapter, on peut apprécier assez correctement la plage de netteté couverte.