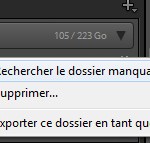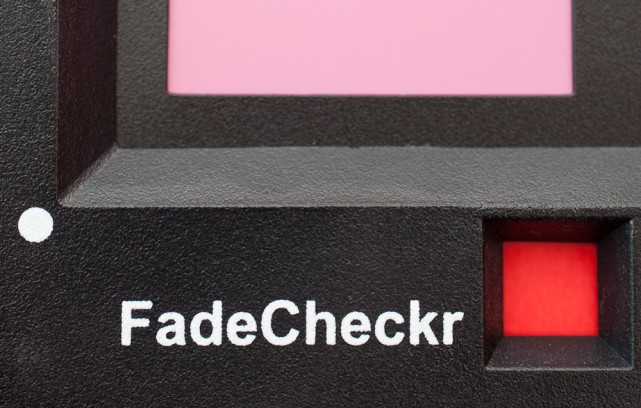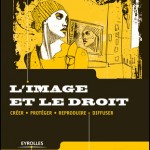Photo d’architecture : démarche informative et/ou approche esthétique ?
Publié le 19 avril 2011 dans Actualités Livres par Gilles Aymard

La photographie de commande
Dans cette approche, le photographe met son savoir-faire et ses qualités d’artiste au service d’un commanditaire qui peut être privé (un architecte, un concepteur, un créateur, un bâtisseur) ou public (une ville, un département, un pays, un musée).
La photographie de commande présente, dans la plupart des cas, un caractère utilitaire, ce qui ne doit pas l’empêcher de posséder de grandes qualités esthétiques, pourvu que l’information véhiculée ne soit pas reléguée au second plan. Les photographies d’un même bâtiment pourront donc être très différentes selon que la demande proviendra de l’architecte, du maître d’ouvrage, des différents corps d‘état ou des fournisseurs de matériaux. Ainsi, l’architecte souhaitera que l’on révèle son travail sur la forme, les volumes, la gestion de la lumière ou l’intégration de son bâtiment dans l’environnement, alors que l’industriel sera sensible à une photographie mettant en valeur son produit dans l’architecture (matériaux de construction, équipements, etc.).
Dans cette approche “utilitaire”, différents buts sont recherchés selon la qualité des commanditaires : archivage et conservation, communication ou publicité.

Auberge des Dauphins, forêt de Saoû. Photographie pour la conservation du patrimoine de la Drôme. © Gilles Aymard (Canon EOS 1 Ds Mk III, objectif TS-E 24 mm f/3,5).
Archivage et conservation
Tout bâtiment est destiné, à plus ou moins long terme, à être démoli, soit volontairement pour être remplacé par un autre bâtiment répondant davantage à de nouvelles exigences d’urbanisme ou de démographie, ce qui est l‘évolution normale des villes, soit par des causes extérieures (guerres, séismes, catastrophes naturelles). La photographie sera une aide précieuse et complémentaire des plans (lorsqu’ils existent) pour restaurer ou reconstruire. Ce fut le cas de la première mission héliographique et des photographies d’Eugène Atget sur les bâtiments de Paris détruits pendant la guerre de 1914-1918.

Quai Claude-Bernard, Lyon, après création du tramway. © Gilles Aymard (Nikon F100, objectif PC Nikkor 28 mm f/3,5).
Communication
Les architectes, par leur appartenance à l’ordre des architectes, ne sont pas autorisés à faire de la publicité directe sur leur personne ou leur agence. Ils peuvent en revanche faire connaître leur travail par le biais de publications (presse quotidienne ou spécialisée) ou l‘édition d’ouvrages. Si le dessin reste le moyen d’expression le plus adapté pour présenter le travail de conception, la photographie permet de montrer le passage du virtuel (dessin) au réel construit, bien plus rassurant pour des donneurs d’ouvrage qui veulent confier leurs projets à des architectes aux solides références, ayant fait leurs preuves dans un domaine particulier. Ces photographies d’architecture illustreront les books de références, livres, magazines, dossiers de concours et de soumission d’appels d’offres.

Valorisation de la création de l’architecte : bureaux de l’agence BBC Architectes. Ce porte-à-faux est l’un des éléments les plus importants dans la conception de ce bâtiment. Il est mis en valeur par un effet de perspective dynamique depuis le premier plan, obtenu grâce à un point de vue rapproché et à un objectif très grand-angulaire à décentrement. © Gilles Aymard (Canon EOS 1Ds Mk III, objectif TS-E 17 mm f/4).