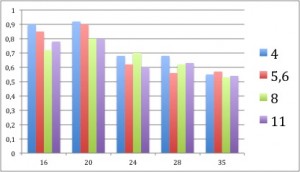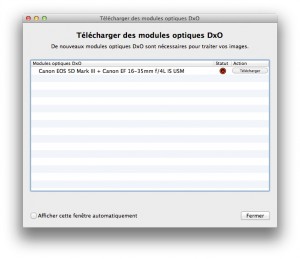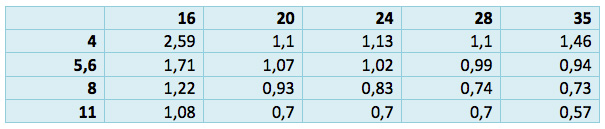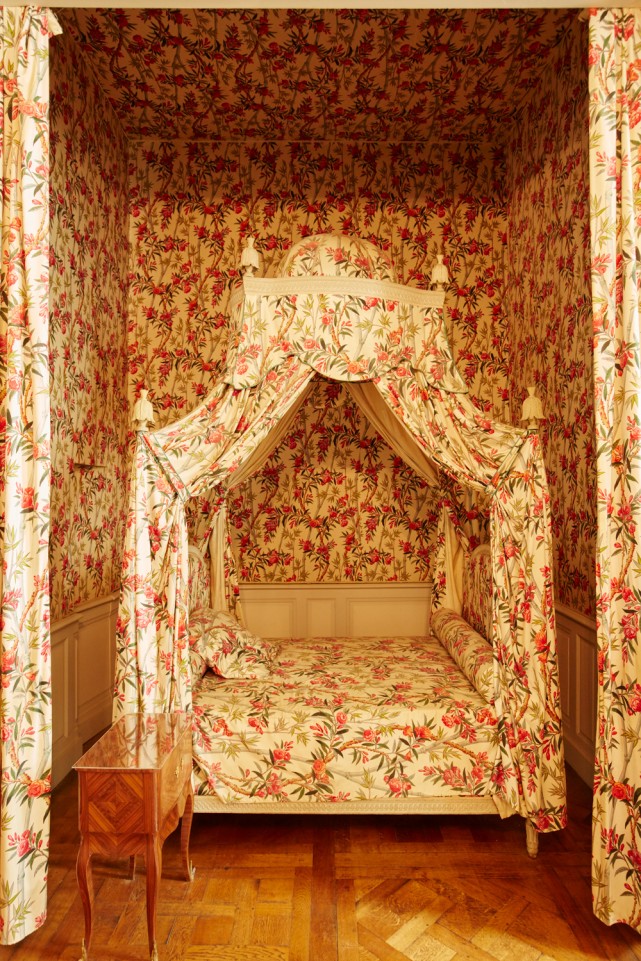AfterShot Pro 2 : la gratuité pour Mac OS
Publié le 8 septembre 2014 dans Actualités par Volker Gilbert

Après avoir repris le développement du logiciel Bibble 5 et l’avoir relancé sous un nouveau nom, AfterShot Pro, l’éditeur de logiciels Corel vient de baisser le tarif de la version actuelle du seul logiciel de flux de production photographique proposé à la fois pour Windows, Mac OS et Linux.